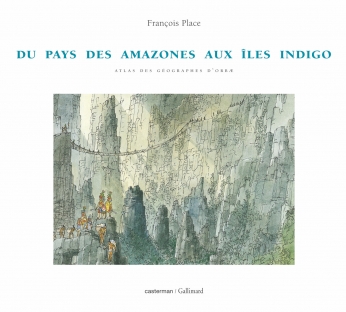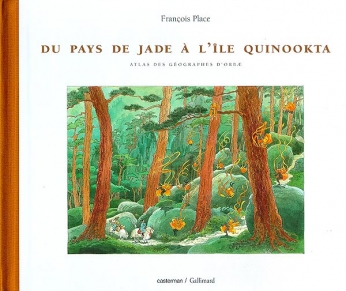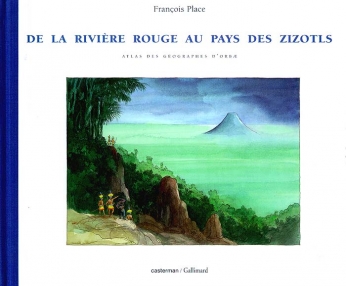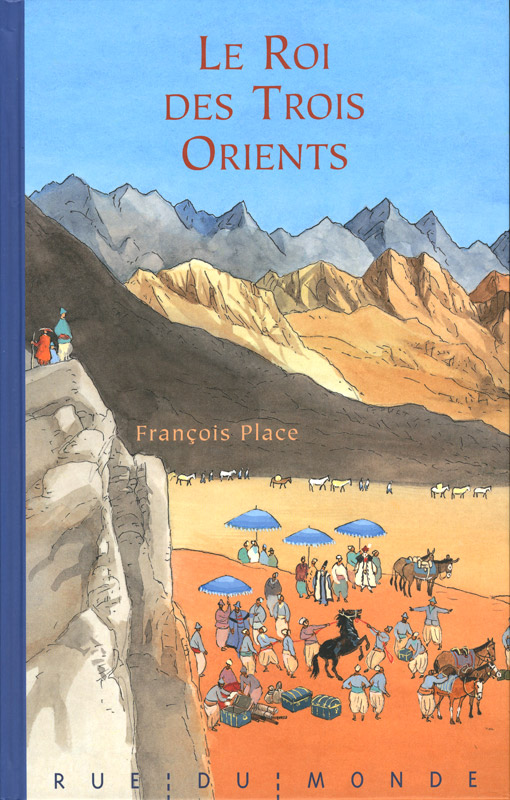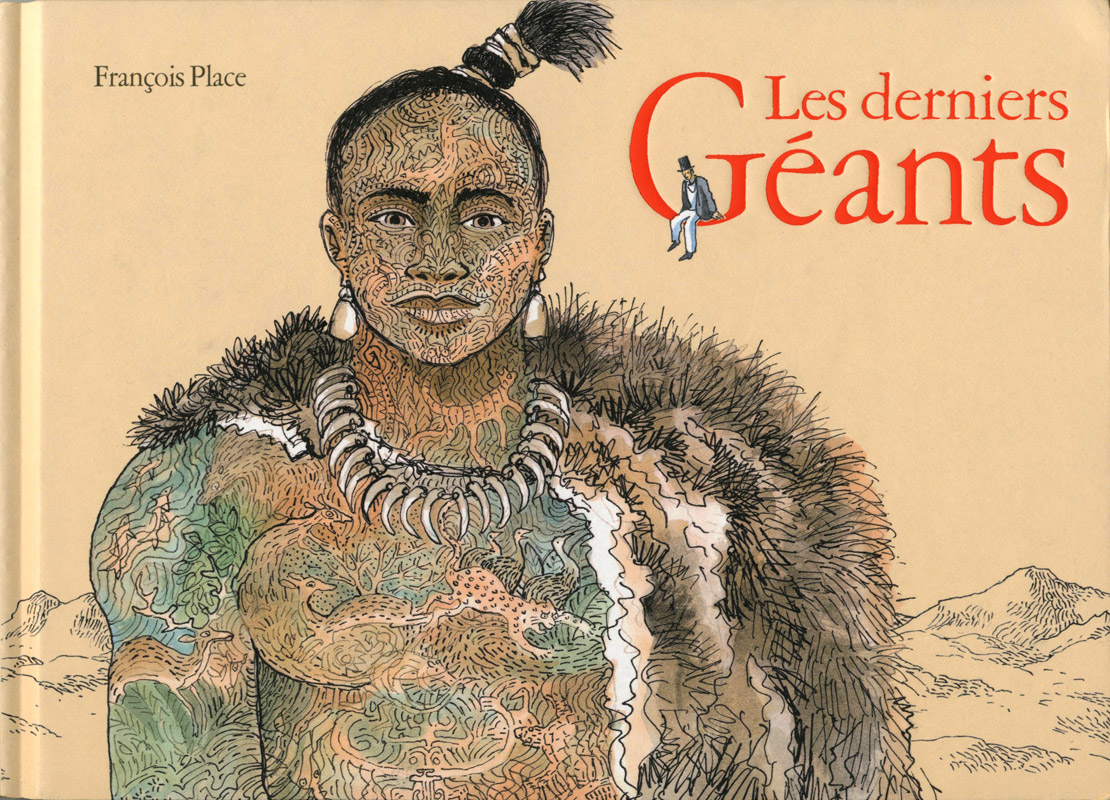Je profite des quelques jours de tranquillité qui me restent avant l’irruption du Spectre des Nuits Courtes pour reprendre la trop longtemps interrompue chronique littéraire (j’ai des excuses : les grossesses fatiguent beaucoup les papas).
Je vous propose donc, puisque vous allez avoir plein de temps, un gros essai accompagné d’un court roman, tous les deux sur le thème de Byzance.
L’essai est écrit non pas par un historien, mais par un spécialiste de stratégie et de géopolitique, du nom de Edward Luttwak : La grande stratégie de l’Empire Byzantin, publié chez Odile Jacob. L’empire Byzantin, issu de la partition de l’Empire Romain en 395 à la mort de l’empereur Theodose, a survécu jusqu’en 1453, c’est-à-dire près de 1000 ans de plus que l’Empire Romain d’Occident (disparu en 476). Or, la situation stratégique de l’Empire Byzantin était nettement plus défavorable que celle de l’Empire Romain d’Occident, du fait de sa forme (un croissant autour de la Méditerranée, allant de la Grèce à la Libye) et de la très grande longueur de ses interminables frontières : au nord le long du Danube avec les menaces permanentes des peuples semi-nomades dont les Huns sont les plus célèbres, à l’Est en Mésopotamie avec l’ennemi héréditaire qu’était l’empire perse des Sassanides, et au sud plus tard celle d’où viendrait la menace Arabe.
Luttwak ne fait donc pas l’histoire de l’Empire Byzantin (c’est d’ailleurs parfois un peu frustrant quand on la connait mal, car il ne prend pas la peine de refaire ne serait-ce qu’une chronologie sommaire des principaux événéments avec des cartes circonstanciées), mais il élabore une théorie très convaincante expliquant la longévité de cet empire si fragile : c’est une stratégie élaborée sur le long terme qui a permis la survivance de l’empire. En effet, très tôt, les Byzantins ont choisi de rompre avec la politique de la force brute menée usuellement par les Romains, pour préférer la politique de la diplomatie subtile : recherche d’alliances stratégiques, espionnage à grande échelle, retournement de ses ennemis les uns contre les autres, adaptation des forces armées aux menaces nouvelles, achat sans vergogne de la paix à coup de lingots d’or, etc.
Ce livre est passionnant parce qu’il permet de comprendre que les événéments historiques ne surviennent pas mystérieusement, mais ont des causes très concrètes voire terre à terre. Un seul exemple, celui de l’avancée inéluctable des Huns, qui m’a toujours paru un mystère absolu. Or, c’est tout simplement la conséquence du fait que les Huns sont arrivés avec un arme d’une efficacité inégalée en Occident, l’arc composite réflexe, qui était d’une puissance de tir telle qu’il permettait de transpercer les boucliers romains tout en restant hors de portée des arcs romains. Ajouté à une cavalerie hors pair, cette arme rendait les Huns littéralement invincibles. De même, et contrairement à la théorie d’une école historique qui est maintenant un peu dépassée, Luttwak montre que les victoires et les défaites sont aussi la conséquence de choix tactiques bien humains : l’orgueil d’un général qui l’entraine à une manoeuvre désastreuse ou au contraire son habilité ou sa hardiesse qui le mène à la victoire.
Bref, c’est un livre qui ne se présente pas comme un livre d’histoire, mais qui en est un complément captivant. Un seul regret : comme tous les livres écrits par des Américains, il est fouilli et le plan laisse à désirer, si bien qu’on a parfois l’impression d’un manque de structuration.

Le roman est beaucoup plus léger, tant par le volume que par le contenu, et je ne l’ai choisi que pour son intrigue byzantine. Il s’agit de Les temps parallèles de Robert Silverberg, prolifique auteur de science-fiction et incontestablement l’un de ceux qui ont lancé le plus d’idées originales maintes fois copiées par d’autres. Cet ouvrage est loin d’être son meilleur, on peut même dire que c’est de la SF certes assez bien ficelée mais qui ne mérite pas qu’on s’y attarde plus d’une soirée. Dans un futur pas si lointain, on propose aux touristes des voyages temporels dans divers lieux et à diverses époques. Le héros, spécialiste de l’histoire byzantine, devient accomagnateur de voyages dans l’Empire Byzantin. Il montre aux touristes les événements les plus marquants et (touristes débiles oblige) les plus people : le siège de Constantinople par les Bulgares, l’impératrice Théodora célèbre pour sa nymphomanie, l’inauguration de la basilique Sainte Sophie, etc. Tout se grippe lorsqu’il tombe amoureux d’une de ses lointaines ancêtres, fille d’une grande famille byzantine. L’intrigue est assez légère, mais Silverberg a cela de bon qu’il est soigneux dans la gestion des paradoxes temporels. Par exemple, à force d’envoyer des touristes voir les principaux événements, il finit par y avoir plus de touristes que d’autochtones autour de Sainte Sophie le jour de son inauguration, ce qui pose des problèmes aux organisateurs. Je parlerai un autre jour de livres un peu plus achevés et sérieux de Silverberg.